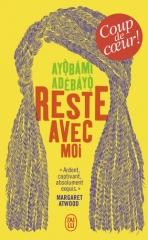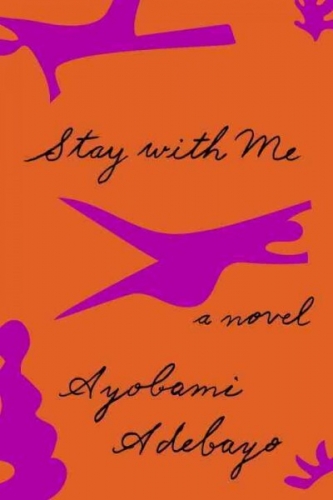Here we are de Graham Swift a été traduit en français (par France Camus-Pichon) sous un autre titre : Le grand jeu (2020). Le romancier britannique excelle à nous entraîner, de livre en livre, dans des milieux différents – ici la scène d’un spectacle de variétés offert aux vacanciers de Brighton durant l’été 1959 – et au cœur des relations entre ses personnages.

Palace Pier, Brighton. Photograph : Heritage Images/Getty Images (The Guardian)
« Jack était maître de cérémonie cette saison-là (sa deuxième) et Ronnie et Evie passaient en premier après l’entracte. C’était grâce à Jack s’ils faisaient partie du spectacle, et c’était bien de passer juste après l’entracte. Quand, ce fameux mois d’août, tout changea et vola en éclats, ils avaient gravi les échelons et passaient en dernier, sans compter le numéro de Jack qui fermait le ban. »
Portant beau son habit noir et blanc, Jack Robinson a le sens du spectacle et de la réclame. Comment Ronnie et Evie sont-ils devenus des vedettes ? Pourquoi ont-ils disparu de la scène au mois d’août ? Jack a en quelque sorte créé leur duo : quand le comédien a retrouvé Ronnie le magicien rencontré quelques années plus tôt durant leur service militaire, il l’a encouragé à prendre une assistante – « la magie plus le glamour, ça devenait vraiment quelque chose. » C’est pourquoi Evie White, en plus de mettre ses jambes en valeur et de sourire, portait une bague de fiançailles.
Contrairement à Jack et à Evie, Ronnie Deane n’a pas grandi avec une mère qui l’a poussé sur scène. Femme de ménage, elle l’a élevé seule dans une maison très modeste, son marin de père presque toujours absent. Vingt ans plus tôt, en 1939, elle l’avait conduit à la gare – une grande campagne nationale invitait les familles londoniennes à envoyer leurs enfants en lieu sûr. Ronnie, à huit ans, était attendu dans l’Oxfordshire, chez M. et Mme Lawrence, Eric et Penelope, « d’un certain âge et sans enfants ».
C’est la chance de sa vie. Ronnie découvre à Evergrene la sécurité et le confort, en plus de la tendresse qu’il n’a jamais connue. Eric et Penny invitent parfois des amis, tous bien habillés et aimables, qui le trouvent « charmant » – « Était-ce ça qu’on entendait par « sortir le grand jeu » ? » Sur les cartes postales envoyées à sa mère, le garçon se contente d’écrire que « tout va bien ». Tout lui semble fantastique dans cette demeure et encore plus le don d’Eric Lawrence, « un magicien accompli », chez qui il va faire son « apprentissage de sorcier ».
Quand il rentre chez sa mère en juin 1945, elle explose de colère quand Ronnie dit vouloir devenir magicien. Il sait qu’il devra se débrouiller seul et que ce sera difficile, son « deuxième père » le lui a assez dit. Lawrence s’appelait Lorenzo à la scène ; Ronnie opte pour son deuxième prénom, Pablo. Au service militaire, il rencontre Jack Robbins – le futur célèbre Jack Robinson. Evie, engagée pour l’assister dans ses « illusions », sera Eve, tout simplement : Pablo et Eve.
En 2009, Evie a 75 ans et vit seule avec ses souvenirs, dans le luxe, grâce à la réussite de son mari à laquelle elle a contribué. Qu’est-il advenu entre-temps de Ronnie ? de Jack ? Graham Swift, « un maître des atmosphères, un talentueux magicien des brouillards et des sentiments » (Didier Jacob dans L’Obs) réserve plus d’une surprise dans Le grand jeu en racontant l’histoire de ces trois-là, de leurs spectacles pleins d’élégance et d’audace et des tournants inattendus de leur vie et de l’amour.